Dix raisons pourquoi aucune équipe canadienne n’a remporté une coupe depuis 30 ans
Les fervents de hockey au Canada rêvent que la Coupe Stanley revienne enfin au pays ce printemps. Tout en espérant que les Maple Leafs, les Oilers ou les Jets brisent le mauvais sort qui afflige les équipes canadiennes, quelques pistes méritent d’être explorées afin de tenter d’expliquer pourquoi la léthargie perdure depuis trois décennies. Même s’il n’y a peut-être pas de réponse claire et définitive pour apporter un éclairage sur cette grande noirceur, voici 10 obstacles qui se dressent entre les marchés canadiens et une conquête du gros trophée.
L’expansion aux États-Unis

En y allant d’un coup de sonde auprès de différents intervenants impliqués dans le monde du hockey ou d’observateurs attentionnés, un constat revient souvent. Inutile de chercher midi à quatorze heures et les ratés récurrents des équipes canadiennes s’expliqueraient simplement parce que le Canada évolue en désavantage numérique depuis trop longtemps.
«En partant, tu n’as que sept équipes canadiennes sur 32. Sur ces sept équipes, il n’y en a pas forcément beaucoup sont de réelles aspitantes d’une année à l’autre. Ça réduit beaucoup le pourcentage de succès», a expliqué simplement l’influent agent québécois Pat Brisson, dans une discussion avec l’auteur de ces lignes
En 1979, au moment de la fusion avec l’AMH, la Ligue nationale comptait 21 équipes, dont sept au Canada, soit le tiers des effectifs. Les Sénateurs sont devenus la huitième formation canadienne de la ligue de 24 équipes, en 1992. Encore une fois, c’était donc le tiers des équipes qui étaient établies en sol canadien.
Avec le déménagement des Nordiques et des Jets au milieu des années 1990, il n’y a eu, pour la période de 2000 à 2011, que six marchés canadiens sur 30 dans la LNH, soit 20%. Aujourd’hui, le ratio de clubs canadiens n’est que de 21,9%.
«C’est le plus gros obstacle. Les chances sont du côté des États-Unis en partant», a fait valoir l’attaquant des Leafs John Tavares, lors d’un récent passage du Journal à Toronto.
«J’ai joué neuf ans à New York (Islanders) et j’ai goûté à la deuxième ronde seulement une fois. C’est extrêmement difficile de gagner la Coupe, que ce soit ici ou aux États-Unis. On le voit en ce moment avec des équipes canadiennes qui ne sont pas du portrait des séries et qui battent de gros clubs», a-t-il poursuivi.
Le format des séries

Au fil des 30 dernières années, même si 15 équipes canadiennes ont atteint le carré d’as, il n’en demeure pas moins que la plupart de celles qui participent au tournoi printanier ne font pas souvent long feu. Comment expliquer ce phénomène?
Premièrement, avant d’espérer veiller tard en séries éliminatoires, encore faut-il se qualifier. Depuis 1994, il est arrivé seulement 12 fois qu’au moins quatre clubs au Canada aient obtenu leur billet la même année. Ce total inclut les séries de 2020 et 2021, dont le format a été modifié en raison de la COVID.
D’ailleurs, en 2021, les équipes canadiennes avaient dû en quelque sorte se canibaliser puisque Montréal avait affronté Toronto et qu’Edmonton avait affronté Winnipeg au premier tour.
Depuis que Winnipeg a retrouvé son équipe en 2011 et que la LNH regroupe sept marchés canadiens, il est arrivé à six reprises que seulement trois formations canadiennes ou moins soient qualifiées.
À cela, il faut ajouter que le format actuel des séries, implanté pour la saison 2013-14, n’a pas toujours donné des duels favorables aux équipes canadiennes. Parlez-en aux Leafs, qui ont plié devant le Lightning, la saison dernière, pour ne citer qu’un exemple.
«On voit des duels de première ronde avec l’intensité qu’on aurait pu voir auparavant en finale de conférence ou en finale de la Coupe. Il y a quelques équipes qui se sont rendues à un septième match et qui n’ont pas fini du bon bord de la clôture. C’est difficile à expliquer», a mentionné John Tavares.
Les opportunités économiques

Même si le Canada montre deux des plus importants marchés de la ligue avec Montréal et Toronto, ce n’est pas la même réalité économique partout au pays.
Québec l’a appris à ses dépens quand les Nordiques ont quitté en 1995 pour ne jamais revenir. Winnipeg a vécu le même affront un an plus tard, avant de retrouver ses Jets en 2011, mais il s’agit de l’un des plus petits marchés du circuit. À différentes époques, Edmonton, Calgary et Ottawa ont aussi connu des soucis financiers.
Même si de manière générale, les marchés canadiens représentent une valeur économique sûre pour la ligue, certains joueurs n’y voient pas la meilleure opportunité de brasser de grosses affaires.
«Il y a davantage de marchés aux États-Unis où il est possible d’aller chercher plus de revenus. New York, Washington, Chicago, Los Angeles, Anaheim, Seattle – un autre marché très riche – ce sont toutes des places ou en plus du salaire, tu peux en plus aller chercher un contrat [de publicité ou comme commanditaire] avec un restaurateur, une compagnie d’avion, un vendeur de beignes, je ne sais pas!
«Il y a plus d’argent à faire là qu’à Ottawa, à Calgary ou à Winnipeg. Le marché canadien reste petit. Un joueur qui évolue aux États-Unis et qui touche un contrat de publicité pourrait avoir un rayonnement national. Et ce rayonnement est beaucoup plus grand qu’au Canada», croit Philip Merrigan, professeur au Département des sciences économiques de l’UQAM et spécialisé notamment en économie du sport professionnel.
Des joueurs réticents?
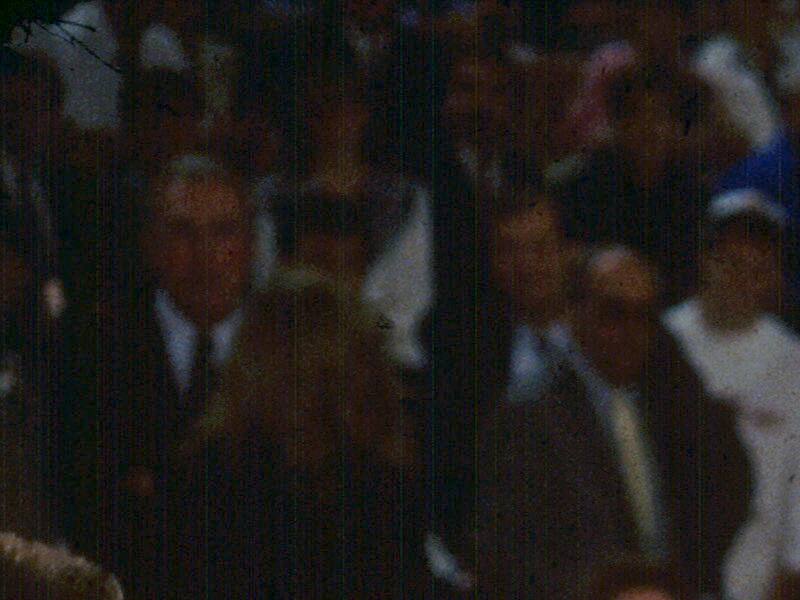
L’agent de joueurs Rick Curran, originaire de Toronto, en a vu de toutes les couleurs avec ses clients au fil de ses 46 années dans le métier. En entrevue, il a spécifié que la première question qu’il demande à ses clients qui deviennent joueurs autonomes est : Veux-tu jouer au Canada ou aux États-Unis?
«Du point de vue économique, il n’y a aucun doute qu’il est plus facile de faire plus d’argent aux États-Unis qu’au Canada, en raison des impôts, des taxes et des lois. Il y a quand même des endroits au Canada, comme à Calgary ou Edmonton, où il est plus avantageux de jouer qu’à Montréal», a-t-il expliqué.
Même s’il y a cette réalité financière à considérer, Curran assure dans le même souffle qu’il ne croit pas qu’il s’agit du facteur le plus déterminant quand un joueur obtient la liberté de choisir sa destination. Il assure même que ce supposé obstacle à la venue de joueurs au pays serait très surestimé.
«Tout le monde pense qu’on ne parle que des chiffres, mais si l’argent est là et que l’équipe est assez compétitive, un marché canadien va convenir.
«Il reste que la plupart des joueurs autonomes de renom font suffisamment d’argent pour faire en sorte que leurs priorités ne seront pas reliées aux facteurs économiques. Ils vont se concentrer sur l’expérience. Ils vont regarder la tradition de l’organisation, la construction de l’équipe, comment sont les installations.»
Des marchés moins attrayants

Les joueurs ne vont pas toujours le crier sur tous les toits, mais l’expansion de la LNH dans des marchés non traditionnels du Sud des États-Unis leur a permis de découvrir des environnements moins friands de hockey, mais où le quotidien devient confortable.
Qu’il s’agisse du soleil de la Floride, des charmes de la Californie ou de la chaleur de l’Arizona, il fait bon vivre entre les matchs et les entraînements.
«Il y a bien sûr des villes comme Edmonton ou Winnipeg, qui seront toujours moins attractives pour les gros joueurs. Pour plusieurs joueurs, il est plus facile de jouer aux Etats-Unis, où ils ne se font pas remarquer», souligne Simon Darnell, professeur à l’Université de Toronto et directeur du Centre d’études sur les politiques du sport.
«Il y a aussi des joueurs comme John Tavares, qui ont choisi de venir au Canada, car ils veulent faire partie de la solution», s’est-il empressé d’ajouter en contrepoids.
Pour sa part, le vétéran défenseur des Leafs Mark Giordano a grandi à Toronto et a évlué toute sa carrière à Calgary et Toronto, à l’exception de 55 matchs à Seattle la saison dernière.
Il ne croit pas que les marchés canadiens soient moins attrayants.
«C’est sûr qu’au Canada, tout est différent. Il n’y a rien comme aller jouer dans un aréna qui est rempli à pleine capacité tous les soirs. Mais personne n’est pareil. Ce ne sont pas tous les joueurs qui vont aimer socialiser et qui vont apprécier le fait que le hockey est tout dans une ville. Il y en a qui ne veulent que jouer, se faire petit et rentrer à la maison.
«Quand on regarde au Canada, pas mal toutes les équipes ont des installations de grande qualité à offrir. Dans les prochaines années, il auront de très bonnes équipes aussi à Vancouver, Ottawa et Montréal», a-t-il analysé.
Voilà un son de cloche partagé par l’agent Pat Brisson.
«Ça vaut la peine d’évaluer la situation, mais je ne pense pas que les joueurs ne veulent pas aller au Canada à cause des taxes ou du climat. J’ai beaucoup de joueurs qui ont évolué dans des marchés canadiens et qui ont aimé l’expérience. J’en ai d’autres qui se sentaient prêts à vivre autre chose parce qu’un moment donné, ça peut devenir trop», a-t-il tempéré.
La pression insoutenable

Quand Pat Brisson glisse que parfois, «ça peut devenir trop» pour un joueur d’évoluer dans un marché canadien, c’est que la marmitte est constamment en ébullition. La pression qui prévaut dans les marchés canadiens n’a rien d’un mythe.
«J’ai des joueurs qui ne veulent rien savoir si je leur mentionne Montréal ou Toronto. Ils ne veulent pas mettre leur famille dans une situation où la pression devient trop forte. Leurs enfants sont à l’école et leur humeur va dépendre d’une victoire ou d’une défaite la veille», a raconté l’agent Rick Curran.
«Je me souviens d’un client qui ne pouvait plus aller pisser sans que quelqu’un lui demande pourquoi il n’avait pas réussi telle ou telle passe la veille. Les premiers temps dans un marché canadien peuvent être maginifiques, mais vient un temps où les gars ne peuvent plus aller nulle part. Ils n’ont plus d’intimité. C’est souvent là que les joueurs vont regarder pour un peu de soleil, où ils ne vont pas se geler le derrière», a-t-il ajouté.
Cette pression, évidemment, ne vient pas que du public exigeant, mais aussi de l’omniprésence médiatique.
«Je pense que dans certaines villes, il y a un problème dans la façon que les équipes planifient leur quotidien avec les médias. Dans la plupart des marchés américains, les joueurs se disent qu’ils ne sont pas accablés de jour en jour par les médias. Les joueurs deviennent étouffés. Dans une place comme Toronto, la pression devient énorme», estime Jean Martineau, vice-président sénior aux communications de l’Avalanche et auparavant avec les Nordiques.
Il s’agit d’un point de vue que réfute l’ancien défenseur et directeur général du Canadien, Serge Savard.
«Je me rappelle que lorsque j’ai fait une transaction pour aller chercher Brian Bellows, il ne voulait pas venir à Montréal. Jacques Demers et moi avions réservé une petite salle à l’aéroport de New York pour aller lui parler. On lui a vanté les bienfaits de la ville, il a accepté et aujourd’hui, il serait le premier à dire que c’était les plus belles années de sa vie.
«Il y en a partout de la pression. Il me semble que c’est un avantage. La pression te rend meilleur. Tout le monde a de la pression dans la vie», a-t-il soutenu vigoureusement.
Une popularité acquise

Certains diront que c’est tiré par les cheveux, mais toutes les explications pour tenter de justifier la longue sécheresse canadienne valent la peine d’être observées. C’est un fait que les équipes au pays bénéficient d’un appui populaire incomparable avec la vaste majorité des équipes américaines. Même quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, les amphithéâtres débordent. Le cas d’Ottawa dans les dernières années demeure une exception à la règle.
Dans ce contexte, même si les organisations font tout en leur pouvoir pour construire des équipes gagnantes, elles ne subissent pas les conséquences d’un public qui les délaisse lorsque le produit sur glace devient moins intéressant, comme c’est le cas à Sunrise, en Arizona, en Caroline ou même dans plusieurs autres marchés américains.
«Que les Leafs gagnent un championnat ou pas, ils demeurent une équipe compétitive, qui siginifie beaucoup pour la ligue. Le développement du sport se passe encore très bien à Toronto avec la plus grosse ligue pour jeunes au monde. Plusieurs étoiles de la ligue proviennent des environs et de cette culture de hockey.
«Si les Leafs perdent encore cette année, ça aura encore l’air d’un désastre, mais les jeunes vont continuer de jouer au hockey, de faire grandir le sport et les partisans n’arrêteront pas d’aller aux matchs des Leafs. Rien ne va changer à ce niveau», a fait valoir Simon Darnell, de l’Université de Toronto.
Le plafond salarial

Personne ne va remettre en doute l’utilité du plafond salarial pour créer la plus grande parité possible. Il n’en demeure pas moins que quelques marchés canadiens dotés d’énormes moyens financiers comme Toronto ou Montréal pourraient frapper de grands coups avec les coudées franches, comme c’est le cas pour les plus gros ténors du baseball majeur, par exemple.
«Un club comme Toronto va bien, mais l’espace sous le plafond salarial est limité. Il faut être très créatif. Edmonton, c’est un peu la même chose», a affirmé Pat Brisson.
Encore là, d’autres diront que le plafond salarial est le même pour toutes les organisations et que les clubs canadiens ne sont pas en peine quand vient le temps de sortir le chéquier.
«Contrairement à d’autres sports, au hockey, le cap salarial est rigide et en théorie, c’est égal pour tout le monde. Ce n’est pas une raison qui explique au’aucune équipe canadienne n’ait gagné en 30 ans. C’est le travail de l’organisation de monter une équipe complète», a plaidé Serge Savard.
La crainte de reconstruire

Pour arriver à leurs fins et gagner une ou plusieurs coupes Stanley, certaines équipes n’hésitent pas à entreprendre des processus de reconstruction complets en liquidant leurs effectifs pour mieux repartir et accumuler de bons choix au repêchage.
Si les Nordiques avaient adopté cette stratégie à la fin des années 1980 et au début des années 1990, le Canadien a pour sa part longtemps résisté à opter pour cette approche.
Dans les 30 dernières années, l’équipe a repêché seulement sept fois dans le top 10 à l’encan annuel. Les Leafs ont profité des repêchages de 2014 à 2016 pour mettre en place leur noyau offensif actuel de William Nylander, Mitch Marner et Auston Matthews au sommet du repêchage, mais auparavant, ils parlaient plutôt en milieu de peloton.
Les Canucks ont eu quatre sélections dans le top 5 en 30 ans, tandis que les Flames en ont eu une seule durant la même période.
Les Oilers faussent la donne avec un ahurissant total de neuf choix dans le top 10 dans les 12 derniers repêchages.
«Il y a aussi un facteur chance au repêchage. Quand on a repêché Cale Makar (en 2017), on espérait le premier choix à la loterie et on se serait sûrement dirigé vers (Nico) Hischier. Il est devenu un très bon joueur, mais jamais il n’a l’impact que Makar peut avoir. Donc sur le coup, c’était une déception de tomber quatrièmes, mais finalement on se retrouve avec un joueur générationnel. Il faut prendre les bonnes décisions, mais aussi avoir un peu de chance», a souri Jean Martineau, du département des communications de l’Avalanche.
La simple malchance

Est-ce que finalement, la déveine des équipes canadiennes ne tiendrait pas de la simple malchance?
«Il y a sept équipes au Canada et dans les dernières 30 années, il y en a seulement six qui ont accédé à la finale. Juste le hasard fait qu’on devrait en avoir 14. Il y a peut-être quelque chose là…», a laissé tomber le professeur Philip Merrigan, spécialisé en économie du sport professionnel.
Plusieurs diront que la malchance n’a rien à voir, mais quand même… Des six équipes qui ont atteint la finale dans les 30 dernières années, quatre ont même vécu l’effervescence d’un match numéro 7. C’est donc dire que l’objectif ultime a été frôlé quelques fois.
Les Canucks n’ont jamais soulevé la Coupe depuis leur arrivée dans la ligue en 1970, mais en 1994, le tir de Nathan LaFayette avait atteint le poteau dans les dernières minutes du match ultime échappé aux mains des Rangers.
En 2004, un but de Martin Gélinas semblait procurer une avance de 3-2 aux Flames en troisième période du sixième match face au Lightning, mais le but a été refusé dans la controverse.
En 2006, la finale avait bien mal débuté pour les Oilers, quand le gardien Dwayne Roloson s’était blessé à un genou et qu’il a raté le reste de la série. Les Hurricanes l’avaient finalement emporté en sept matchs.
Malchance? Hasard? Malédiction? Tous les mots peuvent être valables.
